Image : Manisfestation en Thailande contre la junte militaire du Myanmar. (©Reuters)
Deuxième essai d’une série sur le militantisme des droits de la personne et le ressac démocratique. Cet essai s’intéresse aux stratégies des mouvements sociaux en Asie du Sud-Est pour évaluer le risque de répression dans des contextes de détérioration démocratique. Rédigé par les membres de la CLE Roméo Dallaire sur les conflits et la paix durable et de l’Observatoire des droits de la personne du CÉRIUM Alexandre Lord, étudiant à la maîtrise en science politique à l’Université Laval, et Laurence Déry, candidate au doctorat en études internationales à l’Université Laval, cet essai s’inscrit dans le cadre d’un atelier organisé par la Chaire Roméo Dallaire les 30 et 31 octobre 2024. À travers l’étude des cas des Philippines et de l’Indonésie, cet essai examine les facteurs qui influencent la perception du danger par les activistes, notamment le type de cause qu’ils défendent, la solidité de leur organisation et le soutien dont ils bénéficient à l’international. L’essai met en lumière l’évolution progressive des stratégies répressives des gouvernements populistes, comme le red tagging aux Philippines et la dissolution discrétionnaire des organisations en Indonésie. Enfin, il souligne l’importance des soutiens internationaux dans la protection des militants. Ce deuxième volet prépare le dernier article de la série, qui examinera les tactiques de résistance adoptées par les activistes face aux actions répressives des États.
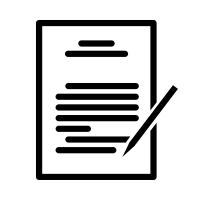
**
Le 30 et 31 octobre 2024, la Chaire de Leadership en enseignement Roméo Dallaire sur les conflits et la paix durable (CLERD) a organisé un atelier intitulé Protest under Duress: Human Rights Activism and Democratic Backsliding in Asia. Cet évènement, organisé par les professeurs Alexandre Pelletier (Université Laval) et Meredith Weiss (State University of New York at Albany), a rassemblé des experts des mouvements sociaux en Asie du Sud-Est pour explorer une question centrale : comment les activistes perçoivent, interprètent et s’adaptent-ils aux environnements marqués par un recul démocratique ?
Ce deuxième article d’une série de trois explore la question suivante : comment les mouvements sociaux évaluent-ils le risque de répression ? D’une part, quels changements menés par l’État sont-ils perçus comme des menaces par les organisations de la société civile ? D’autre part, sur la base de quels critères est-il possible pour les dirigeants de juger le risque de répression ?
À partir des présentations de Dominique Caouette, Margaux Maurel et Dalia Aktouf sur les Philippines et Muhammad Fajar et Rahardhika Utama sur l’Indonésie, il est possible d’identifier un certain nombre de leçons. Ces deux pays, gouvernés par des leaders populistes, ont connu une dégradation marquée de l’espace public dans les dernières années (Lord et Déry, 2024). Conséquemment, les activistes ont dû réévaluer la probabilité qu’ils deviennent des cibles du gouvernement afin de choisir une réponse adéquate et poursuivre leur mobilisation.
Quand l’espace public se referme : comprendre la menace
Dans un contexte de recul démocratique, l’espace public se rétrécit peu à peu. Généralement, les restrictions à la liberté d’expression, de manifestation et de critiquer le gouvernement n’arrive pas d’un seul coup. Les gouvernements préfèrent avancer progressivement pour éviter de provoquer des réactions trop fortes de la population ou de la communauté internationale.
En Asie du Sud-Est, par exemple, les Philippines et l’Indonésie ont développé et mis en œuvre des outils de répression flexibles, conférant ainsi un pouvoir discrétionnaire au gouvernement pour limiter la contestation populaire.
Le cas des Philippines est typique de cette dynamique de répression asymétrique et expansive. Depuis 2016, sous les régimes successifs de Roberto Duterte et de Ferdinand Marcos Jr., la violence s’est intensifiée, ciblant des pans de plus en plus larges de la population et s’attaquant de manière croissante et explicite aux organisations de la société civile. Initialement, Duterte a mis en place un projet de répression en ciblant spécifiquement les consommateurs de drogue. Par la suite, il a progressivement orienté sa stratégie vers les communistes, employant le “red tagging” pour désigner les prétendues menaces à la société. La stratégie du “red tagging” consiste en des accusations infondées du gouvernement envers des activistes, les associant à des partis illégaux de la gauche radicale, notamment communistes (Human Rights Watch, 25 septembre 2024). Cette stratégie est utile pour renforcer le support populaire octroyé au gouverneur populiste en définissant le ‘nous’ du ‘eux’ (Imbong, 2023: 46; Ragragio, 2022: 245). Le red tagging a été particulièrement appliqué à des journalistes et reporters critiques du gouvernement (Khan, 2022: 71). Le résultat des campagnes de red tagging est de répandre la peur chez les activistes pour les amener à s’autocensurer (Kasuya et Hirofumi, 2023: 417). Duterte s’est donc accordé la permission de viser légitimement diverses organisations de la société civile.
En Indonésie, c’est une loi adoptée en 2017 qui a donné au gouvernement de Joko Widodo (Jokowi) des pouvoirs extraordinaires. Le décret sur les organisations de masse et la loi s’y rattachant ont été adoptés cette année, offrant ainsi la possibilité au gouvernement de dissoudre toute organisation qu’il considère problématique. Ce décret est justifié par la protection de la Pancasila, les cinq piliers, l’idéologie nationale indonésienne. Selon Power, cette loi “has the potential to be used as an instrument for more widespread repression of groups deemed hostile to the government” (Power, 2018: 314).
Comment les activistes évaluent-ils la menace ?
Dans ces contextes répressifs, toutes les organisations ne sont pas également à risque. Selon Muhammad Fajar et Rahardhika Utama, deux grands facteurs influencent la probabilité de devenir une cible :
Premièrement, certaines causes sont plus risquées que d’autres. Par exemple, un groupe écologiste est généralement moins susceptible d’être ciblé qu’un groupe anticorruption critiquant ouvertement le gouvernement central. Aux Philippines, les groupes défendant les droits humains et les journalistes sont significativement plus à risque d’être visés par la répression (Ragragio, 2022: 238). En Indonésie, certains mouvements islamistes, notamment le Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ont été visés par le gouvernement pour leur vision radicale de l’Islam, qui ne concordait pas avec la vision gouvernementale (Warburton and Aspinall, 2019: 262). De même,
Deuxièmement, les organisations bien établies, avec beaucoup de membres et un bon réseau de soutien populaire, sont souvent plus difficiles à réprimer. C’est le cas de Karapatan, une organisation chargée de recenser les violations des droits de la personne aux Philippines depuis 1995 a développé des stratégies de résilience, dont l’offre de formation en activisme pour ses membres (Karapatan, 2025). Bref, en tant qu’organisation bien établie, Karapatan a été en mesure de poursuivre son activisme en confrontant le gouvernement malgré la répression subie par l’organisation, notamment celle du red tagging.
En plus de ces dimensions internes, les activistes peuvent aussi compter sur leurs alliés internationaux. Selon Caouette, Maurel et Aktouf, ces soutiens jouent un rôle clé pour alerter l’opinion publique internationale en cas de répression, offrir une porte de sortie (exil ou protection) aux militants les plus en danger, et mettre la pression sur les gouvernements répressifs. Par exemple, en 2020, des organisations internationales journalistiques sont intervenues pour soutenir la directrice du journal Rappeler visée par le gouvernement (Khan, 2022: 73).
L’ensemble de ces facteurs permettent aux organisations d’évaluer le risque de répression gouvernementale potentiel envers leur activisme. Par l’expérience, ces organisations développent leurs propres stratégies pour poursuivre leur activité et naviguer à travers le contexte incertain des régimes en recul démocratique. Ces stratégies seront explorées plus en détail dans le dernier article de cette série.
Conclusion
Dans un contexte de recul démocratique, il est difficile pour les activistes d’évaluer les risques de devenir la cible de répression pour les activistes. Divers critères sont pris en compte pour évaluer ces menaces. D’une part, des facteurs internes comme le type d’activisme mené par le groupe et sa structure organisationnelle jouent un rôle déterminant. D’autre part, les réseaux internationaux offrent un soutien crucial, permettant aux activistes de mieux naviguer dans l’imprévisibilité du contexte politique et de renforcer leur sentiment de sécurité face à la menace.
Dans le troisième et dernier article, nous présenterons deux pratiques de résistances adoptées par les groupes lorsqu’ils deviennent la cible d’actions répressives de la part du gouvernement. Plus précisément, ces pratiques sont l’utilisation des cellulaires, notamment des vidéos en direct, ainsi que le changement d’échelle, passant d’un activisme local à international.
Références
1.Human Rights Watch, 25 septembre 2024. « Philippines: Dangerous ‘Red Tagging’ of Labor Leaders ». Human Rights Watch. URL: https://www.hrw.org/news/2024/09/25/philippines-dangerous-red-tagging-labor-leaders (Consulté le 15-01-2025)
2.Imbong, Regletto Aldrich, éd. 2023. Authoritarian Disaster: The Duterte Regime and the Prospects for Marcos Presidency. Asian Political, Economic and Social Issues. New York: Nova Science Publishers, Incorporated.
3.Imbong, Regletto Aldrich. « The Performativity of Terror-Tagging and the Prospects for a Marcos Presidency », Dans Imbong, Regletto Aldrich (ed.), 2023. Authoritarian Disaster: The Duterte Regime and the Prospects for a Marcos Presidency. New York: Nova Science Publishers. pp. 43-64.
4.Karapatan. 2025. « About KARAPATAN ». Karapatan. URL : https://www.karapatan.org/about/ (Page consultée le 28-02-2025)
5.Kasuya, Yuko, et Hirofumi Miwa. 2023. « Pretending to Support? Duterte’s Popularity and Democratic Backsliding in the Philippines ». Journal of East Asian Studies, septembre, 1‑27.
6.Lord, Alexandre et Laurence Déry, 6 décembre 2024. « Protest under Duress: l’activisme en contexte de recul démocratique (1 de 3) », Observatoire des droits de la personne (ODP), URL: https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2053 (Page consultée le 17-02-2025).
7.Power, Thomas P. 2018. « Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline ». Bulletin of Indonesian Economic Studies 54 (3): 307‑38.
8.Ragragio, Jefferson Lyndon D. 2022. « Facebook Populism: Mediatized Narratives of Exclusionary Nationalism in the Philippines ». Asian Journal of Communication 32 (3): 234‑50.
9.Warburton, Eve, Edward Aspinall, et Post-doctoral research fellow at the Asia Research Institute, National University of Singapore. 2018. « Explaining Indonesia’s Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion ». Contemporary Southeast Asia 41 (2): 255‑85.

Image : Membres de l’atelier de la Chaire de leadership en enseignement Roméo Dallaire

